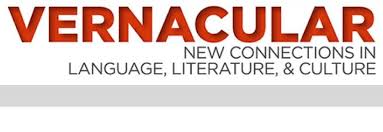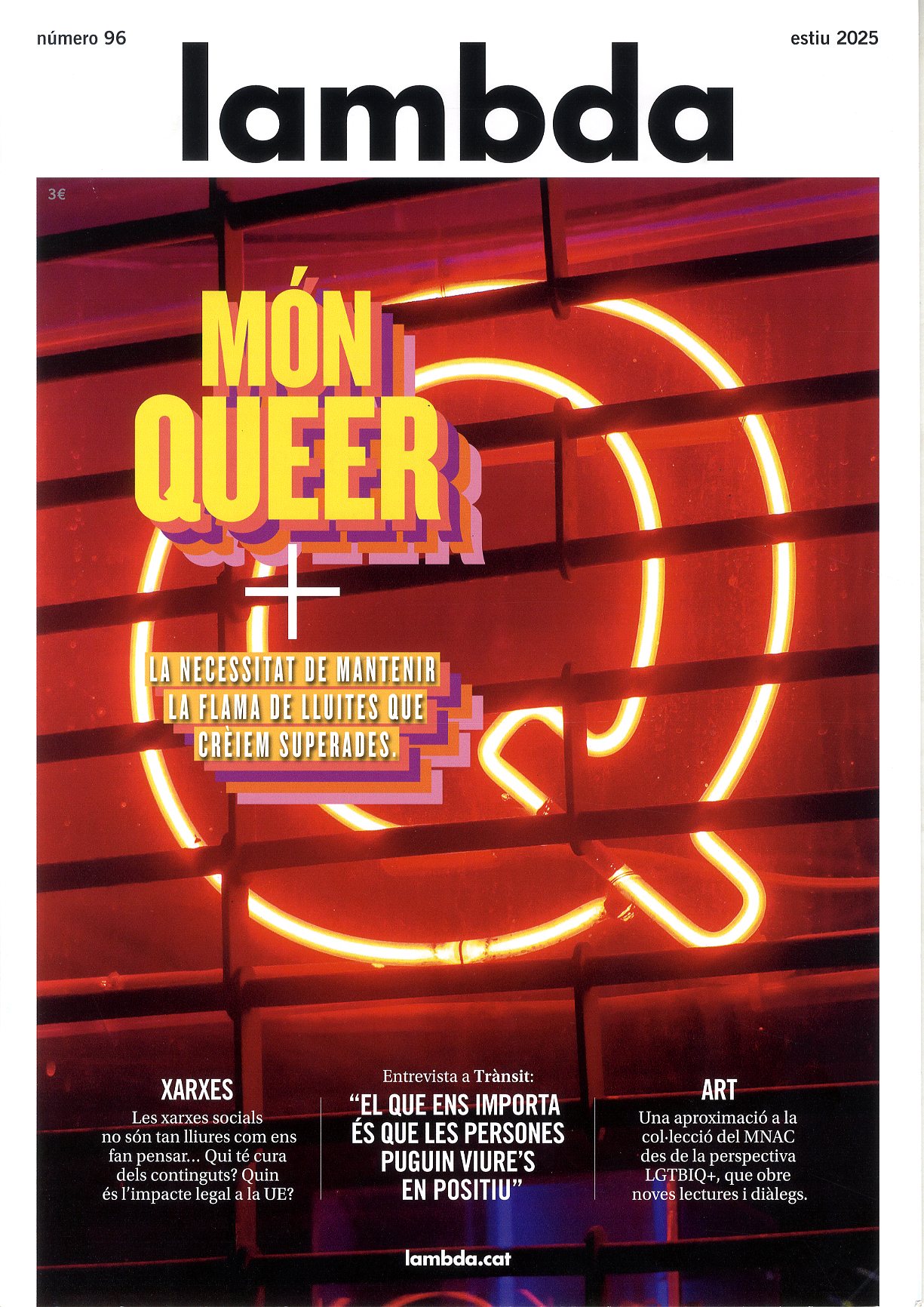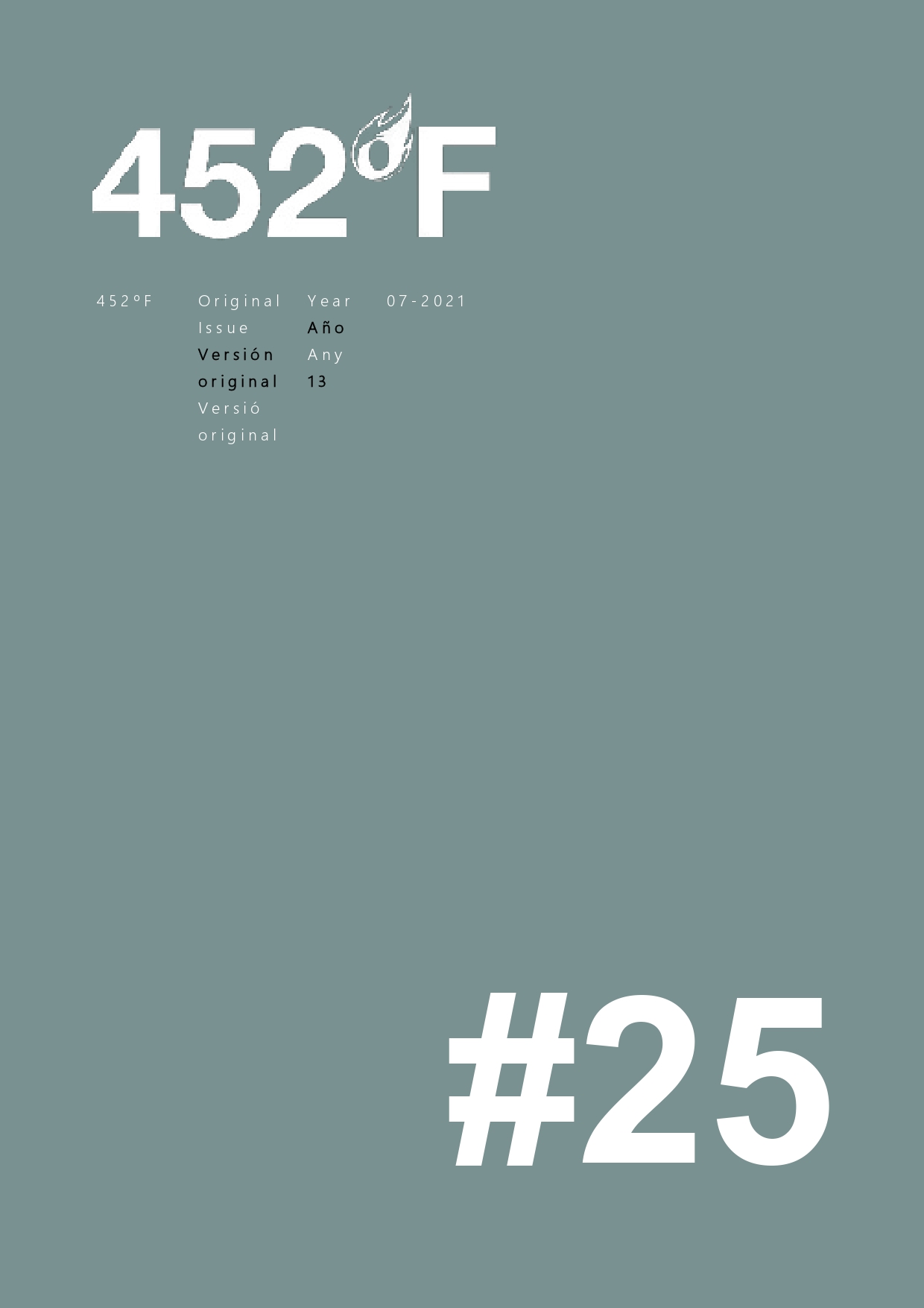Resumen
C’est à travers les ouvrages À l’ami qui ne m’a pas sauvé (1990) d’Hervé Guibert et Dans ma chambre de Guillaume Dustan que nous essayons de comprendre le monde de ceux qui ont été stigmatisé comme des fléaux de la société. Dans les années quatre-vingt-dix, les recherches avancent pour aider ceux qui sont atteints du SIDA mais seulement quelques-uns réussissent à se faire soigner. Guibert et Dustan nous font revivre leurs moments de désuétude où la société les rejettent. Cette recherche met en avant l’écriture sidéenne qui se veut souvent « crue » et parle par l’intermédiaire du corps qui rongé par la maladie exprime ce que le sidéen ne peut dire. C’est à travers la voix off du moment présent, les paroles banales du quotidien comme des descriptions de la vie quotidienne, le vocabulaire restreint voulu par les auteurs qui permettent à l’écriture sidéenne de prendre vie par le langage de la corporéité. Le corps change d’identité et se transforme dès la contamination. C’est maintenant un corps sidéen qui s’exprime par ses désirs, par ses besoins, par ses faiblesses, par ses marques physiques et par son envie de se reproduire. Je souhaite démontrer que l’écriture sidéenne est une écriture qui existe par l’intermédiaire du corps : la parole de la corporéité et s’exprime sur ses désirs, ses besoins, ses faiblesses et ses marques physiques afin d’éduquer et d'éveiller les consciences sur l’urgence du virus qui se propage, tue toujours beaucoup de vie et n’épargne personne.